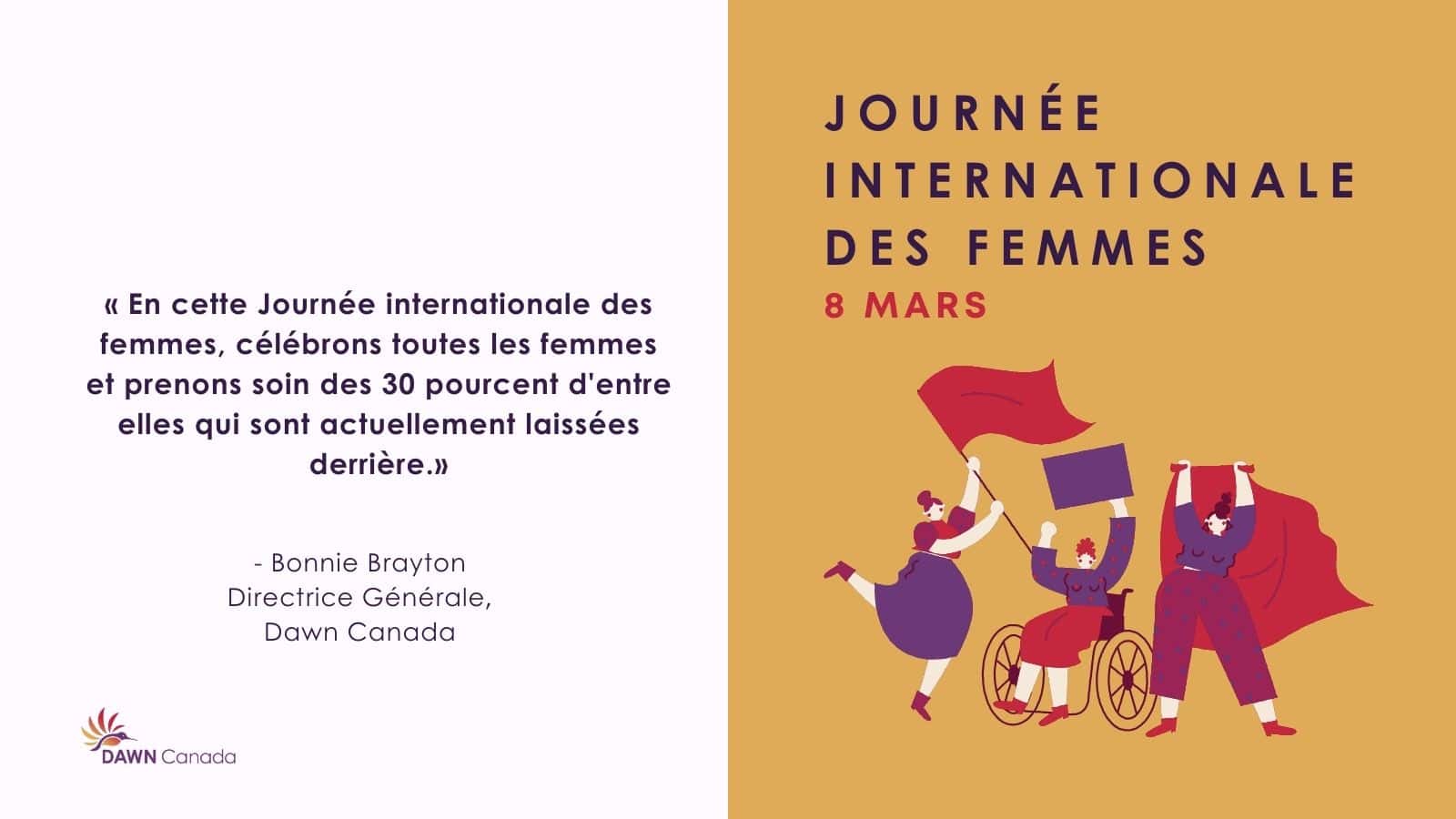24 février 2025
Q & A with Associate Director of the Harriet Tubman Institute and Associate Professor at York University, and academic partner of DAWN Canada, Ruth Rodney, RN, PHD
Quel rôle les histoires jouent elles dans vos activités de plaidoyer et vos travaux universitaires?
Je me dis souvent que nous, les Noirs, sommes les meilleurs et les plus extraordinaires conteurs d’histoires! Les histoires qui ont marqué mon enfance étaient plus qu’un simple divertissement; elles étaient des leçons de vie, des sources de sagesse, des rassemblements joyeux et des moyens de transmettre des connaissances essentielles. Je dirais donc qu’en plus d’être au cœur de mon travail, les histoires sont un aspect essentiel de l’appartenance aux communautés noires et de la croissance qui s’y opère.
Je considère également que les histoires sont l’un des plus beaux cadeaux que nos ancêtres nous aient transmis. Même si je ne sais pas exactement de quelle région d’Afrique viennent mes ancêtres, je continue de découvrir des mots, des phrases et des histoires dans le dialecte guyanais qui remontent au continent africain. C’est l’un de nos liens les plus sacrés à un passé dont nous avons été dépouillés. Les histoires garantissent que même en cas de déplacement, nous conservons quelque chose de nos origines.
Les histoires jouent également un rôle essentiel en raison de leurs racines profondément ancrées dans la tradition orale, un moyen de partage des connaissances qui existait bien avant les documents écrits. Dans mes travaux sur la violence fondée sur le sexe, je me concentre sur les histoires des femmes. J’honore leur voix de différentes manières. J’ai, par exemple, utilisé leurs paroles comme titres d’articles et je m’assure toujours d’inclure leurs propos dans les diverses publications auxquelles je collabore, m’inspirant de leurs expériences vécues pour façonner de nouvelles façons de penser. Leurs histoires ne sont pas de simples données – elles sont le fondement de mes recherches et de mes actions de plaidoyer.
Je prends grand soin des histoires qui me sont confiées, car elles sont plus que de simples souvenirs; ce sont des actes de résistance, de survie et de mémoire. À travers elles, je cherche à amplifier des voix qui ont longtemps été réduites au silence et à honorer le pouvoir de la narration en tant que force transformatrice.
Comment vous assurez vous que votre travail reste inclusif et accessible aux communautés marginalisées?
Voilà une excellente question, à laquelle je réfléchis constamment. Veiller à ce que mon travail reste inclusif et accessible aux communautés est un engagement de tous les instants. Je me demande toujours qui a accès à la connaissance, de qui la voix est amplifiée et qui est exclu des espaces de recherche et des histoires. Je suis toujours prête à écouter, à apprendre et à me responsabiliser pour donner suite à ce qui a été exprimé – en particulier si j’ai fait une erreur ou si j’ai manqué quelque chose en cours de route.
L’un des moyens d’y parvenir est de travailler en collaboration avec des organisations et des groupes communautaires. Aucune des recherches que j’ai menées jusqu’à présent n’a été menée de manière isolée. Il s’agit plutôt d’efforts collectifs qui reposent sur ce que les communautés marginalisées considèrent comme étant le plus important pour elles. Deuxièmement, j’accorde une attention particulière à la manière dont les connaissances sont partagées – en utilisant un langage clair et accessible et en veillant à ce que mes recherches soient entendues et comprises par les communautés qu’elles cherchent à mobiliser. Le jargon universitaire et les obstacles institutionnels peuvent aliéner les personnes les plus touchées par notre travail. Je m’attache donc à rendre les résultats significatifs par le biais de forums communautaires, d’études publiques et de formats alternatifs à la publication traditionnelle.
Il est tout aussi important de veiller à ce que les espaces de recherche et les équipes au sein desquelles je travaille soient accessibles. Je me demande régulièrement qui manque, non seulement en raison de l’accès physique ou numérique, mais aussi en ce qui concerne la création d’environnements où les gens se sentent valorisés et entendus. Pour moi, l’inclusion n’est pas une case à cocher. C’est un processus continu d’auto évaluation, d’apprentissage et de responsabilisation. Je m’engage à poser des questions difficiles sur le pouvoir, les privilèges et l’exclusion, à la fois dans le cadre de mes recherches et dans celui des systèmes plus vastes qui les façonnent. Le travail n’est jamais terminé, mais il est essentiel.
Quels changements systémiques jugez vous nécessaires pour créer une société plus équitable pour les personnes noires en situation de handicap?
Selon moi, pour que la société devienne plus équitable pour les personnes noires en situation de handicap, il nous faut repenser les systèmes qui façonnent nos vies. Ces deux identités – la couleur de la peau et le handicap – sont confrontées à des barrières structurelles et, ensemble, elles révèlent une société qui les a longtemps dévalorisées et exclues. La profonde méfiance à l’égard de ces systèmes n’est pas sans fondement. Elle découle d’antécédents de négligence, de violence et d’échecs systémiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement, ce que j’ai pu observer directement à travers les expériences des membres de ma propre famille.
Pour moi, le véritable changement ne réside pas dans la simple inclusion, si cela signifie naviguer dans des espaces qui n’ont jamais été conçus dans un souci d’attention ou de justice. Trop souvent, les personnes marginalisées sont placées dans des environnements qui restent intrinsèquement violents, où elles doivent encore se battre pour être vues et valorisées. Pour moi, ce n’est pas de la justice; c’est une adaptation à l’oppression.
Je pense que les changements systémiques sont anticoloniaux. J’entends par là qu’il faut s’employer à ériger des systèmes et des structures qui soient fondés sur nos propres connaissances, plutôt que de simplement réformer un système défaillant. Il faut créer des espaces qui reflètent nos valeurs d’intégrité, d’amour et de célébration de la différence comme une force et non comme un déficit. Il ne s’agit pas seulement de mesures d’adaptation, mais d’une véritable appartenance, où les personnes noires en situation de handicap jouent un rôle central dans le façonnement de la société, au lieu d’être considérées comme des éléments secondaires.
Pour y parvenir, il faut démanteler les structures fondées sur le capacitisme et la discrimination à l’égard des Noirs dans les domaines de la politique, de l’éducation, des soins de santé et de l’économie, tout en amplifiant leurs voix depuis longtemps réduites au silence. Cela signifie qu’il faut redistribuer le pouvoir et les ressources et veiller à ce que les soins soient fondamentaux et non facultatifs. Le changement n’est ni facile ni simple, mais il est nécessaire. Et pour moi, cela commence par le refus d’accepter le monde tel qu’il est.